Alors que Blondel s’intéressait plus particulièrement à la notion de Christianisme, Deleuze aborde Nietzsche sous l’angle plus
« classique » de la généalogie, de la déconstruction, des origines ; c’est l’abord classique de Foucault, Deleuze, Derrida.
A
l’instar de Blondel, Deleuze[1] a bien compris que le
projet nietzschéen était tout sauf nihiliste ; il s’agit en effet, non pas de nier le sens, mais de le créer, de le recréer. « Le projet le plus général de Nietzsche consiste en ceci : introduire en philosophie les concepts de sens et de valeur. » Rien de moins nihiliste que
cela.
Pour créer les valeurs et le sens, Nietzsche fait appel à la démarche généalogique, c’est-à-dire remonter aux
sources historiques de ce que l’on croit éternel et ainsi montrer l’historicité, la relativité d’une idée ou d’une croyance. C’est ce que Deleuze suggère dans un chiasme bienvenu :
« Généalogie veut dire à la fois valeur de l’origine et origine des valeurs. »
Mais rappelons-nous ce que nous avions décelé dans la lecture de Blondel : la volonté de puissance est jeu de différentiel,
manifestation de force à l’égard du monde ; comment penser le sens dans le cadre même de la force, de la volonté de puissance ? (peut-être Derrida aurait-il pu faire un jeu de mots
comme volonté de pui-sens) Chez Deleuze, le sens est précisément cela même dont s’empare la force ; la force exprime le sens en s’en emparant. « Tous les sens ne se valent pas. Une
chose a autant de sens qu’il y a de forces capables de s’en emparer. » Deleuze affirme lui aussi que la volonté désire affirmer sa puissance, sa force, et le sens naît de cette volonté
d’affirmation ; seulement, poursuit-il, en affirmant sa force, elle se prend dans le réseau différentiel, et loin de chercher la « réconciliation » hégélienne, elle culmine en
l’affirmation de sa différence[2]. La
volonté de puissance est donc, d’emblée, chez Deleuze, marquée du sceau de l’anti-hégélianisme.
D’où provient le sens dans ces conditions ? Nous l’avons vu, d’une force, capable d’interpréter
la chose. La volonté de puissance est interprétation. Mais comment exprimer cette interprétation, comment dire le sens ? Dire le sens, n’est-ce pas nécessairement utiliser des catégories
grammaticales, elles-mêmes figées, pleines de relents métaphysiques nauséabonds ? Nietzsche est contraint d’inventer ou d’utiliser une autre forme que celle du texte construit, soumis aux
catégories métaphysiques de la grammaire : ce sera l’aphorisme. « Seul l’aphorisme est capable de dire le sens, l’aphorisme est l’interprétation et
l’art d’évaluer : il dit les valeurs. »
Deleuze propose pour clore le premier chapitre une des fulgurances dont il a le secret, autour du tragique. Le tragique est lié à Dionysos comme jouissance du multiple, de la différence ; le jeu différentiel, le jeu de l’irréductible pluralité c’est cela même le tragique. Le tragique survient comme la contingence du multiple, de laquelle naît la nécessité. Le monde est un nombre infini de dés, dont le résultat est la sommation nécessaire de chacun d’entre eux. « Les dés qu’on lance une fois sont l’affirmation du hasard, la combinaison qu’ils forment en tombant est l’affirmation de la nécessité. La nécessité s’affirme du hasard, au sens exact où l’être s’affirme du devenir et l’un du multiple. » Ce jeu différentiel contingent produit la nécessité comme le devenir produit l’Etre. Si bien que la tragique comme affirmation du hasard est affirmation de la nécessité, car toute affirmation est prise dans le devenir donc dans l’Etre.
Disons-le tout de suite, la fulgurance deleuzienne est plus fulgurante (si je puis dire) que juste ; il y a là un
pseudo-raisonnement par association, qui joue sur des concepts opposés, afin de les faire correspondre, d’une manière tout hégélienne. De surcroît, il y a un présupposé ininterrogé de la
conclusion : l’Etre est nécessité. Or, rien n’est moins sûr. L’Etre comme nécessité, c’est une reprise métaphysique, dont Deleuze est somme toute coutumier. Bref, j’ai tendance à me méfier
des coups d’éclat deleuziens qui ne convainquent que les inconditionnels du vieux Deleuze.
Le deuxième chapitre aborde un couple conceptuel au cœur de l’interprétation deleuzienne de
Nietzsche : l’actif et le réactif. Deleuze propose une lecture très personnelle de ce couple : « Tout rapport de forces constitue un corps. » et « Dans un corps, les
forces supérieures ou dominantes sont dites actives, les forces inférieures ou dominées sont dites réactives. » C’est typiquement là le Deleuze que je n’aime pas. Qu’est-ce qu’un corps dans
ce contexte ? Evidemment pas le corps physiologique puisqu’il s’agit d’un rapport de forces, donc d’une dualité, et le corps n’est pas duel ; Deleuze emploie ici le corps au sens
mathématique du terme ; c’est un ensemble défini par deux lois de composition interne. Ces pseudo-mathématiques souvent utilisées par Deleuze (et Baudrillard) sont absolument ridicules et ne
cherchent qu’à asseoir un vocabulaire flottant et somme toute pédant.
Les forces supérieures du corps, on l’aura
compris, ce sont les forces de la volonté ; inversement, les forces réactives, ce sont celles de la conscience ; la conscience est réaction du moi qui cherche à affirmer son unité face
à la pluralité, face au jeu différentiel du monde. Volonté et conscience forment donc un corps, au sens mathématique, tout en ayant des déterminations physiologiques ; il y a là, très
certainement, un jeu de mots sur le sens du « corps », dont Deleuze aurait pu faire l’économie.
Comment
mesurer les forces ? Deleuze avance deux critères : qualitatifs et quantitatifs. Très curieusement, Deleuze voit chez Nietzsche un primat de la quantité sur la qualité, un passage de la
qualité à la quantité, sans même s’apercevoir qu’il s’agit là, encore une fois, d’une démarche teintée d’hégélianisme. La quantité succède à la qualité, et s’oppose à l’identité comme la
pluralité à l’unité. Quelle que soit la chose, elle est pourvue d’une qualité ; c’est sa première détermination, et cela c’est du Hegel. En revanche, la quantité de force est seconde, et la
volonté de puissance est cela même à partir de quoi se différencient qualitativement une première fois les choses, puis quantitativement, puis à nouveau qualitativement ; différence et
répétition… Nous avons donc là une volonté de puissance comme origine de la différence et de la répétition, une volonté de puissance qui n’est pas activité, qui n’est pas force, mais qui est
origine ; elle est ce à partir de quoi la chose prend son sens, par le jeu différentiel.
Le chapitre se clôt, très curieusement, sur une dialectique de la négation de la négation, sur une négation
de la réaction qui engendre l’activité, la force active. Comment Deleuze peut-il attribuer autant d’hégélianisme à Nietzsche tout en refusant radicalement le hégélianisme de Nietzsche ?
La réponse est simple : parce que Deleuze a toujours davantage recherché la fulgurance et la formule que la rigueur conceptuelle.
Le troisième chapitre se présente comme une mise en pratique de la démarche généalogique.
Peut-il y avoir une science non réactive ? Oui, ce sera la science des « symptômes ». Au lieu d’étudier le phénomène pour lui-même, on s’intéressera à lui en tant que symptôme, en
tant que porteur d’un sens qu’il s’agit de décrypter. On en établira sa typologie (qualité) et sa généalogie (noblesse / bassesse) La volonté de puissance n’est donc pas ce qui désire, elle est
ce qui donne du sens, elle est ce qui octroie sa propre volonté à la chose. Le problème de Kant est qu’il « a conçu la critique comme une force qui devait porter sur toutes les prétentions à
la connaissance et à la vérité, mais non pas sur la connaissance elle – même, non pas sur la vérité elle même. » Kant en est resté aux conditions par lesquelles on formait une
représentation, par lesquelles on connaissait justement, mais il n’a pas exercé la critique à l’égard de la vérité elle-même ; il ne s’est pas demandé à quelle condition de possibilité on
pouvait parler de vérité.
Alors que la vie est exercice de la volonté de puissance, la connaissance est
réactive ; elle est recherche de l’unité au mépris de la complexité différentielle du réel. La tâche de la pensée ne doit plus être de former des connaissances, mais bien plutôt d’inventer
de nouvelles possibilités de vie. « La vie faisant de la pensée quelque chose d’actif, la pensée faisant de la vie quelque chose d’affirmatif. » tel est le projet
nietzschéen.
Quelles sont les conséquences d’une telle association de la vie et de la pensée ? Tout simplement
que la pensée n’a plus pour tâche de fonder le vrai, le vrai n’est plus l’élément de la pensée ; désormais, le sens et la valeur sont les objets de la pensée.
Moralement, les forces réactives désignent une attitude très
précise : le ressentiment. Consciemment, la réaction est ressentiment ; inconsciemment, elle est préservation de traces mnésiques. L’homme du ressentiment vit au passif, et au passé. Il
a besoin de la méchanceté des autres pour se sentir bon ; plus les autres sont méchants, plus il se sent pur ; plus autrui est indigne, laid, plus il se croit porteur d’une valeur
morale. Il forme le sophisme suivant ; tu es méchant, donc je suis bon. En somme, le positif n’existe que comme négation. (je ne voudrais pas insister lourdement, mais ça c’est encore du
Hegel)
D’où proviennent le bien et le mal ? Ce sont des valeurs créées, naturellement historiques, et absolument
pas absolues ; elles résultent d’une suspension de l’action ; en se retenant d’agir, on transforme le bon et le mauvais en bien et en mal. Ce qui était physiologique devient moral.
« Cessant d’être agies, les forces réactives projettent l’image renversée » Et cela, c’est le prêtre judaïque qui l’a fait en premier. La force active suspendue se retourne contre
soi et devient douleur, douleur intense, douleur accusatoire. Et « on fait de la douleur la conséquence d’un péché, d’une faute. » La douleur est punition volontaire, intériorisée,
« la douleur ne paie plus que les intérêts de la dette ; la douleur est intériorisée, la responsabilité est devenue responsabilité culpabilité. »
L’idéal qui exprime le triomphe des idées réactives, du ressentiment, c’est l’idéal ascétique. Et le moteur de ces forces, c’est le
nihilisme.
Le dernier chapitre est
consacré à la polémique contre Hegel ; le surhomme est contre la dialectique hégélienne ; disons le tout de suite, je ne suis pas convaincu par cette interprétation. Nietzsche serait
contre l’immanence des valeurs, l’homme de la réaction serait l’homme hégélien, en creux ; « il ne connaît plus de valeurs supérieures à la vie, mais seulement une vie réactive qui se
contente de soi, qui prétend sécréter ses propres valeurs. » Et cela ce serait l’homme hégélien.
La mauvaise
conscience est réinterprétation de la conscience malheureuse de la Phénoménologie de l’esprit. La dialectique, ce sont « les forces réactives qui s’expriment dans l’opposition,
c’est la volonté de néant qui s’exprime dans le travail du négatif. » Il y a là une magnifique mauvaise foi de la part de Deleuze ; le négatif est le moteur dialectique, en aucun cas
son issue ; Deleuze feint de croire que le négatif est cela même sur quoi débouche la dialectique alors qu’elle n’est que le moyen par lequel s’accomplit l’absolu. C’est d’autant plus erroné
que Nietzsche ne cesse de procéder par négatif, aussi bien dans la vie active que réactive ; l’homme du ressentiment est bon par négation du méchant, mais inversement, l’homme de l’action,
celui qui exerce sa volonté de puissance est pris dans un jeu différentiel qui suppose précisément, dans le cadre de son accomplissement, qu’il soit en mesure de nier tout en dépassant
(aufheben) le monde en sa différence. Le par-delà bien et mal que désire Nietzsche n’est pas si éloigné que le pense Deleuze de l’absolu hégélien, de la réconciliation hégélienne qui
cherche, elle aussi, à ne plus être soumise à des couples d’opposition binaire. La manière par laquelle Deleuze interprète le travail du négatif comme nihilisme est pour cette raison
inacceptable : elle serait juste si le négatif était le terme de la dialectique, mais ce n’est pas le cas.
En conclusion, outre cet anti-hégélianisme très primaire de Deleuze, fondé sur un refus de l’activité
positive du négatif, et sur une mésinterprétation profonde de Hegel, Nietzsche et la philosophie demeure un ouvrage de référence, notamment en raison du couple interprétatif réactif /
actif, et de la volonté de puissance comme source du sens. « Que le multiple, le devenir, le hasard soient objet d’affirmation pure, tel est le sens de la philosophie de
Nietzsche. »
[1] Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962
[2] N’oublions jamais que le maître-ouvrage de Deleuze sera Différence et répétition
Les philosophies de Nietzsche et Deleuze ont en commun que la pensée, comme la vie qu’elle recèle, n’est que mouvements. Mouvements rapides et hétérogènes parcourant les surfaces, comprenant
l’être lui-même comme surface à traverser. Mouvements et surface organisent un jeu, celui de la pensée. Ce jeu, que Deleuze appellera « le jeu idéal », est à comparer par ses
spécificités aux sports. Mais si la pensée, par son mouvement intempestif, saute toutes les limites, le sport ne peut trouver sa validation que par la limite même. Le sport paraît alors être une
pensée sédentarisée face à la déterritorialisation de toutes pensées, de celles qui réalisent l’être en dehors d’un temps, d’un sens, d’une mémoire ou d’une histoire.

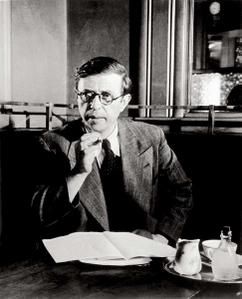



Pour commander ce DVD, rendez-vous sur la boutique de L214.
L'équipe de L214
contact@L214.com -
www.L214.com
Si vous souhaitez vous désinscrire à la lettre d'information L214/Stop Gavage, signalez-le simplement à contact@L214.com

Qui arrêtera Sarkozy dans la démagogie à l’égard des religions ?
Après avoir vanté le mois dernier devant des dignitaires de l'Eglise catholique les "racines chrétiennes de la France", Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois exalté lundi 14 janvier l'héritage "civilisateur" des religions, cette fois en Arabie saoudite devant des dignitaires du très rigoriste régime saoudien, à chaque fois dans des termes inédits pour le chef d'un Etat laïque.
A Rome, en insistant sur les "racines chrétiennes de la France", il s’est permis d’affirmer qu’il défendait une laïcité dite "positive", c'est-à-dire "qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas les religions comme un danger, mais un atout". Il a critiqué une laïcité "épuisée" et menacée par "le fanatisme", allant jusqu'à juger de l'intérêt de la République d'avoir "beaucoup d'hommes et de femmes" qui "croient" et qui "espèrent".
Le 14 janvier, il s’est encore plus engagé lors de son séjour en Arabie saoudite, devant les 150 membres du Conseil consultatif (Majlis ach-Choura) du royaume. A côté de propos convenus dénonçant l'intégrisme, "négation de l'Islam" et réaffirmant sa volonté d'éviter "le choc des civilisations" , il a tenu des propos en totale contradiction avec la réserve qui doit être celle du chef d’un Etat laïc, en rappelant ce qu’il prétend être les "racines religieuses" du monde.
"Dans le fond de chaque civilisation, il y a quelque chose de religieux", a-t-il assuré, estimant que "c'est peut-être dans le religieux que ce qu'il y a d'universel dans les civilisations est le plus fort". Tel un prédicateur devant une méga-church américaine, il a évoqué "Dieu qui n'asservit pas l'homme mais qui le libère", "Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le coeur de chaque homme" ou encore "Dieu qui est le rempart contre l'orgueil démesuré et la folie des hommes", pour regretter que son message ait "souvent été dénaturé".
Nous ne comprenons pas que les défenseurs de la laïcité, que ce soit dans l’opposition ou dans la majorité, ne relèvent pas vertement ces propos. Une interpellation à l’Assemblée Nationale serait le minimum, face aux débordements d’un président emporté par la haute idée qu’il se fait de lui et qui manifestement abuse gravement de ses pouvoirs.
Nous aimerions par ailleurs savoir comment les représentants de mouvements religieux islamistes particulièrement agressifs prendront de telles déclarations. Comme un encouragement à poursuivre la conversion des Européens à leurs valeurs ? 16/01/08

 " Imaginons que dans les années 1910-1920 Valéry,
Cocteau, Cendrars, Apollinaire et Larbaud aient été un seul et même homme, caché sous plusieurs « masques » : on aura une idée de l'aventure vécue à la même époque au Portugal par
celui qui a écrit à lui tout seul les œuvres d'au moins cinq « écrivains de génie. »
" Imaginons que dans les années 1910-1920 Valéry,
Cocteau, Cendrars, Apollinaire et Larbaud aient été un seul et même homme, caché sous plusieurs « masques » : on aura une idée de l'aventure vécue à la même époque au Portugal par
celui qui a écrit à lui tout seul les œuvres d'au moins cinq « écrivains de génie. »
Bureau de Tabac
Recueil de poésie
Editions Caractères
Langue d'origine : portugais,
Traduit par Armand Guibert 2000,
Première édition : 1955
Extrait
« Je ne suis rien
Jamais je ne serai rien.
Je ne puis vouloir être rien.
Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde.
Fenêtres de ma chambre,
de ma chambre dans la fourmilière humaine unité ignorée (et si l'on savait ce qu'elle est, que saurait-on de plus ?),
vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel,
sur une rue inaccessible à toutes les pensées,
réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise,
avec le mystère des choses enfoui sous les pierres et les êtres,
avec la mort qui parsème les murs de moisissure et de cheveux blancs les humains,
avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien.
Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je connaissais la vérité;
lucide aujourd'hui, comme si j "étais à l'article de la mort,
n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses
que celle d'un adieu, cette maison et ce côté de la rue
se muant en une file de wagons, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête,
un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent.
Je suis aujourd'hui perplexe. comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié.
Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois
au Bureau de Tabac d'en face, en tant que chose extérieurement réelle
et la sensation que tout est songe, en tant que chose réelle vue du dedans.
J'ai tout raté.
Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien.
Les bons principes qu'on m'a inculqués,
je les ai fuis par la fenêtre de la cour.
Je m'en fus aux champs avec de grands desseins,
mais là je n'ai trouvé qu'herbes et arbres,
et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde.
Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. A quoi penser ? … »
La première traduction française de ce livre, par Armand Guibert, fut publiée par Bruno Durocher en 1955. Le recueil réédité en 2000 reste un ouvrage de référence.
Une édition bilingue de l'ouvrage est parue chez Unes, augmentée d'une préface de Adolfo Casais Monteiro et d'une postface de Pierre Hourcade.
Sites pour découvrir Fernando Pessoa
Publications sur Pessoa et le Portugal
Association Française des Amis de Fernando Pessoa
|
|
|
|
|
lundi 31 décembre 2007 - par Claire Mercier
Naissance Le blog de L'Originel Meilleurs Voeux pour 2008
Quelques messages sont déjà parus. |